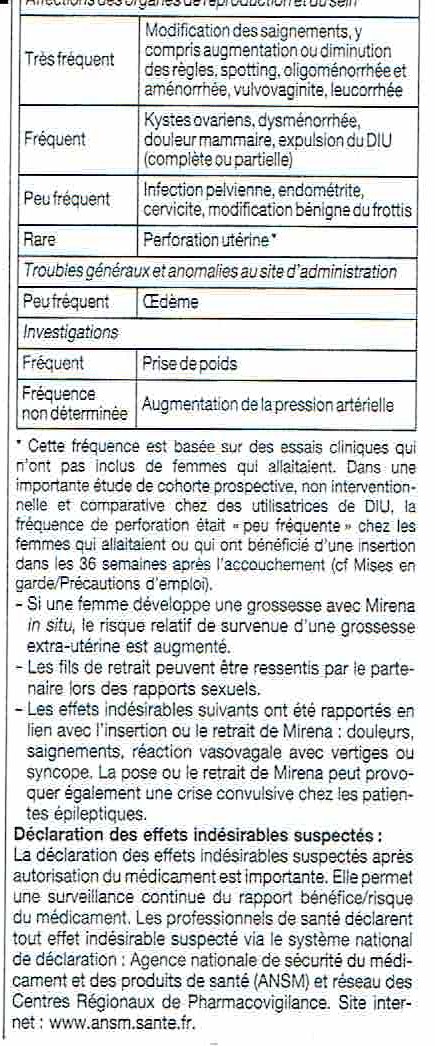Notre alerte de
2014 à la direction
Dès le début de la
réflexion nationale sur les vigilances sanitaires, j’ai éclairé notre
direction. En effet, le 19 juin 2014, j’écrivais :
« (…)
Cette coordination devrait se construire dans le sens
suivant : de la base vers le sommet. De l’échelon local et territorial en
remontant vers la strate régionale puis le niveau national…
L’expérience acquise à proximité directe du sujet
devrait servir de fil conducteur à la construction du dispositif.
La documentation d’un cas signalé ne peut se faire de
façon sérieuse, exhaustive et efficiente qu’au niveau local, à proximité directe
du dossier et des praticiens en charge de ce dernier. La qualité des
informations recueillies et transmises en dépend. Et cette qualité de l’information
-remontée – conditionne directement celle de l’analyse, des conclusions et des
décisions.
Cette remarque appelle à s’interroger également sur la
qualité des informations qui sont envoyées directement par le patient lui-même.
Ce dernier n’étant pas nécessairement un expert du domaine. L’accompagnement du
patient est donc une question qui mériterait d’être soulevée.
(…)
Le signalement invite à organiser aussi les modalités
qui permettent de garantir la sécurité, la confidentialité et l’anonymisation
des données requises par le secret médical durant toutes les étapes du
dispositif des vigilances sanitaires.
(…) »
Réponse à notre
message de 2014 envoyé au Ministère de la Santé
Le 1er juillet
2014, je reçois une réponse m’indiquant : « Nous avons bien reçu votre message. Il a été transmis à Madame la Ministre. »
Puis, plus rien.
Découverte fortuite
d’un portail de signalement qui aurait coûté deux millions d’euros
Finalement, le
ministère de la santé, lui, adopte une démarche inverse. J’ai appris, par hasard, l’existence d’une nouvelle plateforme
sensée recueillir les signalements des effets indésirables présumés d’origine
médicamenteuse.
Une plateforme
inutile, nuisible et coûteuse : vers une dilution, une noyade, des signaux
importants
Désormais, n’importe
qui peut déclarer un effet indésirable en l’imputant à tel ou tel médicament.
Il suffit qu’une
personne se connecte à Internet pour accéder à cette plateforme.
Prenons l’exemple d’un
décès qui survient dans un établissement de santé. Un membre de la famille peut
déclarer ce décès via cette plateforme sans même informer le médecin qui
suivait le patient décédé. La direction de l’établissement aussi ne sera pas
informée.
À cette étonnante
méthode s’ajoute le fait que, depuis peu et avant la mise en place de cette
plateforme, tout effet indésirable doit être déclaré. Alors qu’auparavant, l’obligation
réglementaire de signalement ne concernait que les effets indésirables graves
et/ou inattendus.
Le même effet
indésirable peut alors être déclaré par différents moyens et auprès de
plusieurs organes. Des doublons…
Cette orientation
prise ne peut que conduire à la dilution des signaux importants. Les cas graves et/ou inattendus peuvent être
noyés dans une masse d’informations transmises sans contrôle préalable.
La qualité de ces
données interroge.
Le secret
professionnel (médical) pourrait être malmené.
Une expérience menée
par des journalistes
« En deux clics, Le Figaro a d’ailleurs réalisé trois fausses déclarations. Penelope
Prisma (nom fictif) âgée de 22 ans a ainsi utilisé un gel douche à l’abricot
causant des démangeaisons, a mal été prise en charge à l’hôpital (sans même
préciser lequel), et enfin, s’est vue saigner du nez après avoir pris de la Thalidomide,
une vieille molécule utilisée dans les années 1950-1960 comme anti-nauséeux,
responsable de malformations importantes et aujourd’hui réservée aux
prescriptions hospitalières. Sera-t-elle prise en compte ? En tout cas
elle encombre le système. »
« Les pharmacovigilants avaient prévenu : ce
sera une « usine à gaz »»
« Pour la modique somme de deux millions d’euros,
Marisol Touraine a créé… » cette plateforme.
« Le gouvernement de l’époque [2009-2011] avait un peu triché en matière de communication
pour dire que cette réglementation intervenait dans le cadre de l’après-Mediator »
« La plateforme permet également des déclarations
anonymes »
« La base nationale de pharmacovigilance va ainsi être
polluée »
« On appauvrit le sytème déjà existant en créant
un outil qui ne servira à rien à part générer des faux bruits concernant des
effets indésirables qui n’en seraient pas »
À lire absolument
(tout l’article).
Conclusion
D’une incontestable
sous-notification des effets indésirables graves et/ou inattendus, la
pharmacovigilance semble être entraînée vers la voie d’une sur-notification de
tout effet indésirable par n’importe qui.
Dans le même temps,
certains se plaignent d’un manque de moyens en pharmacovigilance.
Une déclaration de
pharmacovigilance ne se limite pas à un simple signalement administratif. Elle
nécessite la transmission d’un dossier bien documenté et médicalement validé.
Cela contribue à la qualité et à la puissance des études notamment
épidémiologiques qui pourraient être effectuées ultérieurement. Parfois,
plusieurs mois sont nécessaires pour pouvoir documenter valablement un dossier.
Par ces motifs non
exhaustifs, l’arrêt de cette plateforme, notamment, me semble être une action
envisageable et dans les meilleurs délais.